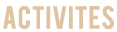Après des débuts dans le hard-bop (avec Dizzy, Blue Mitchell etc) et des groupes latinos, Chick Corea remplace Herbie Hancock dans le quintet de Miles, en 1968, et découvre les claviers électriques. Qu’il utilisera abondamment au sein d’un des principaux groupes de jazz-rock des seventies, Return to Forever. Dans les années ’80, il réalise l’exploit de diriger deux groupes très différents avec les mêmes musiciens de base : l’Elektric Band et l’Akoustic Band dans lesquels il est entouré par le bassiste virtuose John Patitucci et par le batteur Dave Weckl. En 1991, ils participent au premier festival Jazz à Liège avec le trio acoustique, que voici à quelques semaines d’intervalles dans une version de How deep is the ocean.
Le premier était altiste, il vient de nous quitter. Son jeu fluide avait jadis transfiguré le langage parkérien et fait de lui un des créateurs du jazz cool. Le second était ténor et comme le premier, il inventait une nouvelle manière de pratiquer le jazz moderne. Ils avaient tous deux un gourou, un pianiste hors normes qui s’appelait Lennie Tristano. Le premier s’appelait Lee Konitz, le second Warne Marsh. En 1958, dans une des superbes émissions The subject is jazz, dont nous avons déjà vu des extraits, Konitz et Marsh illustrent ce jazz cool plus intellectuel sans doute que celui de Chet Baker ou de Stan Getz. Avec Don Elliott (mellophone) Billy Taylor (pn) Mundell Lowe (gt) Ed Safranski (cb) et Ed Thigpen (dms), ils jouent Half Nelson de Miles Davis. Vous avez dit cool ?
Et si pour la première fois au cours de ce rituel quotidien, on s’offrait une courte page de dixieland. Du vrai, celui des Chicagoans des années ‘20/’30, ces gamins blancs de l’Austin High School, fous des premiers disques de l’Original Dixieland Jazz Band, de la musique de Bix Beiderbecke et plus encore du jazz profond des pionniers blacks orléanais (King Oliver, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong). Moins de blues (et pour cause) et plus d’excentricité dans leur musique, mais aussi et peut-être surtout, une « défense et illustration du jazz », cette certitude que la musique d’Armstrong ou de Bechet n’était pas que de la musique mais une nouvelle vision du monde. Ces gamins plus ou moins doués selon les cas mais qui furent les premiers grands propagateurs du jazz, leur religion. Ces dixielanders parfois un peu clownesques et néanmoins très sérieux dans leur exhubérance, qui fumaient de la muta pour « masquer la laideur du monde » et qui avaient pour nom Pee Wee Russell (cl) Bobby Hackett (cn – futur modèle de Miles Davis), George Brunies (tb), Eddie Condon (gt) Dave Bowman (pn) Clyde Newcombe (cb) ou Johnny Blowers (dms) : dans ce show de 1938, ils jouent un des hymnes du dixieland, At the jazz band ball.
Retour aux archives de l’INA avec un extrait du concert donné par le trio de Martial Solal lors du festival de Juan les Pins en 1960. Comme Toots, Bobby Jaspar et quelques autres, Solal est un des rares musiciens européens à avoir réussi à infiltrer le marché américain avec une musique qui ne se voulait pas un clone du jazz made in USA. Une inflitration qui n’était évidemment pas à la mesure de son talent. Son langage est unique, imaginatif, virtuose. Avec Guy Pedersen et le jeune Daniel Humair, il joue la plus célèbre composition de Duke Jordan, Jordu. Des décennies plus tard, au Conservatoire de Liège, entre deux sets d’un concert de Solal en piano solo, j’ai entendu deux snobinards qui s’étaient sans doute trompé de jour ou de salle, dire avec un petit sourire moqueur : « Oui, c’est un bon pianiste de bar ». Ah si j’avais eu quelques années de plus…
Il y a quelque jours, le 14 juin, le pianiste Keith Tippett, figure marquante du progressive jazz anglais des années ‘60/’70 (King Crimson, Centipede…) tirait sa révérence. Un de plus. En 1970, il avait épousé l’éblouissante Julie Driscoll, chanteuse emblématique du rock psyché britannique et partenaire de l’organiste Brian Auger. Ayant toujours flirté aux frontières du rock, de la soul et du jazz, elle poursuivrait sa carrière comme chanteuse de jazz sous le nom de Julie Tippett, sans jamais retrouver pour autant l’incroyable charisme qui était le sien en 1968-69, lorsqu’elle chantait Season of the witch, Save me ou cet inoubliable Road to Cairo. La mélodie envoutante, la voix puissante et sensible de Julie Driscoll, ce look irrésistible et ces boulersantes paroles de David Ackles (réécoutez-les, ou traduisez-les si vous ne parlez pas anglais), rien n’est à jeter dans cette chanson qui fait partie de celles qu’on emportera sans hésiter sur l’ile déserte.
Pendant de longues années, Duke Ellington a eu à ses côtés la plus incroyable section de saxophonistes qui se puisse imaginer : capables de travailler comme un seul homme, chacun de ces cinq musiciens étaient aussi de formidables solistes, dotés d’une personnalité hors normes. Ils servaient la musique du Duke et Duke les servait en écrivant pour eux des pièces sur mesure. Ces “super-héros” du jazz s’appelaient Johnny Hodges (as), Russell Procope (as, cl), Jimmy Hamilton (cl), Harry Carney (bs, cl) et Paul Gonsalves (cb). Alcoolique au dernier degré, s’endormant en plein concert, Gonsalves apportait à l’orchestre du Duke une modernité saisissante, à l’aide notamment d’un phrasé alliant avec une efficacité étrange Ben Webster, Benny Golson et Eric Dolphy (eh oui). On connait Paul Gonsalves pour sa performance au festival de Newport en 1956. Mais il pouvait aussi se montrer un spécialiste bouleversant des ballades ellingtoniennes : Happy Reunion par exemple, filmé en 1967 par la télévision danoise.
Un superbe document réalisé, pour l’essentiel en Guinée, par Thomas Roebers et Floris Leeuwenberg. Foli est le mot malinké désignant le rythme. Le rythme c’est la musique. La musique c’est la vie. En retournant aux racines, ce petit film aux images fascinantes, superbement monté, nous rappelle en passant la place de la musique et de l’art dans la vie. Ne pouvant ou ne voulant pas le comprendre, nos dirigeants privilégient les équations économiques, les coalitions politiques et cette formule démoniaque « Progrès = Profit ». Reléguant aux oubliettes, sous prétexte qu’il s’agit de luxe et de superflu, toutes ces choses autrement vitales pour l’humanité. Si on ajoute que le culturel et le social sont intimement liés, on a tout compris. Pas sûr que la crise du Corona parviendra, comme certains l’ont espéré, à changer les paradigmes. Les Trumps de tout poil continueront sans doute hélas à écraser à coup de milliards le visage des George Floyd, des musiciens de rue et des délaissés du pognon. Pas de vie sans respiration, pas de respiration sans rythme, pas de vie sans musique : I can’t breathe ! A moins qu’on ne se décide à respirer ensemble une bonne fois pour toutes. En rythme !
1964, Charles Lloyd crée ce superbe quartet avec le jeune Keith Jarrett, Cecil Mc Bee et Jack de Johnette. Il devient ensuite, avec les mêmes, un des premiers jazzmen adeptes du flower power. Longue, longue carrière, et ce flair pour engager à chaque génération, comme Miles, les musiciens qui ont un truc spécial à dire. Je me souviens de ce concert à Gand où Charles était malade, recouvert de couches de pulls, de manteaux, d’écharpes. Il a commencé à jouer, et très vite, sous le regard désapprobateur de son épouse/agent, la chaleur l’a envahi, comme elle nous a envahis, et au-revoir les manteaux, la passion était là, encore et toujours. Ce lyrisme post-coltranien unique servi pour ce concert de Marciac par le piano de Jason Moran, la contrebasse de Harish Raghavan et la batterie d’Eric Harland.
Marciac 2016. Bob Hurst, vingt ans plus tôt pilier du mouvement neo-bop aux côtés des Marsalis, ouvre la porte à la voix et au piano de Diana Krall, revenue au jazz après quelques épisodes un peu moins intenses. Place ensuite à monsieur Anthony Wilson, merveilleux guitariste et partenaire privilégié de la dame depuis de longues années, puis à la dame elle-même, à qui il restera toujours un petit quelque chose de l’influence initiale de Nat King Cole, même si son jeu s’est évidemment largement modernisé depuis. Ajoutez un Kariem Riggins très inspiré à la batterie et vous voilà avec pour démarrer la journée un très beau All or nothing at all à ajouter à cette liste de confinement - en fin de parcours espérons-le (ça me fera tout bizarre, le jour où ça arrivera).
Depuis 1992, L’Ame des Poètes (Pierre Vaiana, Fabien Degryse, Jean-Louis Rassinfosse) explore, revisite, réinvente la chanson française sous toutes ses formes (de Brel au Grand Jojo, de Piaf à Ferré). Le neuvième album de ce trio décalé ou lyrique, iconoclaste ou respectueux, vient de sortir. Au menu, des chansons françaises évidemment, mais issues de métissages divers. L’occasion d’un petit retour en arrière avec un medley de deux chansons cultes du répertoire de Brassens, Le Gorille et Les copains d’abord, filmées au centre culturel de Remicourt en 2013.
L’école de Joan Chamorro à Barcelone est un cas. Unique en Europe voire au-delà. Loin de l’académisme des grandes écoles pour surdoués gonflés de technique, il apprend à ses étudiants (toutes générations et tous niveaux confondus, avec au moins autant de filles que de mecs) à sentir le jazz, à le vivre de l’intérieur. Il sera encore temps de révolutionner le monde musical une fois les fondamentaux acquis. Ceux du cœur. Juste avant le confinement, on se préparait à aller écouter un concert de la bande de Chamorro avec Andrea Motis à Marchin. Bernique. Heureusement, il y a des tas de videos de ces jeunes qui en veulent sur youtube. Ne vous privez pas. Aujourd’hui, ce sera une version de Yesterdays par la TRES jeune trompettiste Alba Armengou. Derrière elle, de beaux arrangements pour la section de saxophones. Tomorrow is another day.
1960. Pour accompagner un spectacle, Quincy Jones amène en Europe un fabuleux big band (peut-être le meilleur qu’il ait jamais dirigé). Comme toujours dans ce cas de figure, les télévisions locales (hollandaises, françaises, allemandes, belges…) profitent de l’aubaine non seulement pour filmer l’orchestre au complet mais aussi pour capter des prestations plus décontractées de « bands within the band » qui jouent des standards ou des thèmes de Parker ou de Monk. Dans cette émission française présentée par Sim Coppans, Scrapple from the apple et Now’s the time est joué par par Clark Terry (tp) Jimmy Cleveland (tb) Phil Woods (as) Budd Johnson (ts) Patti Bown (pn) Buddy Catlett (cb) et Joe Harris (dms). Le générique d’ouverture mentionne des musiciens qui participaient à d’autres séquences de l’émission. Et encore merci à l’INA pour le travail de mémoire !
1939. En plein mouvement revival, Sidney Bechet s’écarte des normes orléanaises pour enregistrer pour le jeune label Blue Note une des plus belles, des plus bouleversantes et des plus intemporelles versions du Summertime de Gershwin. Des dizaines de musiciens ont tenté d’imiter le son inimitable, le vibrato, les blue notes et le phrasé du « Vieil Homme ». En vain. Lorsque Wynton Marsalis entend le saxophoniste français Olivier Franc (qui joue sur le soprano de Bechet), il n’en croit pas ses oreilles (qui pourtant en ont entendu d’autres). Et lorsqu’il rend hommage au maître à Marciac en 2009, il demande à Olivier Franc de ressusciter le Summertime historique. Je vous laisse apprécier !
Paris 1960. Le 25 novembre, la tournée du JATP passe par la Salle Pleyel. Pour ce Sweet Georgia Brown, deux solistes de haut vol, J.J.Johnson (tb) et Stan Getz (ts) et la section rythmique qui, à l’époque, accompagne Cannonball Adderley : le pianiste anglais Victor Feldman (qui trois ans plus tard jouera avec Miles en Californie), le bassiste Sam Jones et le batteur Louis Hayes. Ni be-bop, ni cool, ni hard-bop, du bop tout simplement, et qui swingue à vous faire péter une durite.
Avec Nduduzo Makhatini ou Moses Taiwa Molelekwa, la relève de Dollar Brand/Abdullah Ibrahim et d’Hugh Masekela est désormais assurée. Le très beau clip centré sur Amathambo (2018) est une bonne manière d’entrer dans l’univers de Makhatini : mélopées sud-africaines mêlées à des arrangements jazz pimentés d’improvisations freeisantes et d’images tantôt provocantes, tantôt émouvantes, trip aux frontières de l’Afrique d’avant-hier et celle d’aujourd’hui, on entre dans le week-end en déconfinant respectueusement les genres sans déraper vers la soupe aseptisée qu’on nous sert à tous les repas.
Thelonious Sphere Monk is Thelonious Sphere Monk. Bien sûr, avec Charlie Parker, Dizzy, Charlie Christian et Kenny Clarke, il a mis le be-bop et le jazz moderne sur les rails. Bien sûr, il est le seul à sortir des blue notes d’un piano. Bien sûr, ses maîtres sont les grands pianistes stride de Harlem, James P. Johnson, Willie the Lion Smith et Fats Waller et lorsqu’il joue des standards en solo, il invente et réinvente le stride martien. Bien sûr il a offert au jazz un répertoire tellement intemporel que tout le monde se l’approprie aujourd’hui encore. Bien sûr, il est fou et rond comme une sphère anguleuse, il rit comme il pleure et danse sur scène comme personne. Bien sûr, sa musique est d’ici et d’ailleurs, totalement. Si vous croisez un de ces soirs la Baronne ou l’un de ses chats, elle pourra vous en dire bien plus que moi sur Thelonious Sphere Monk. Elle vous dira notamment à quoi il pensait ce 17 mars 1966 en enregistrant, à Copenhague, cette version de Don’t blame me. Croyez-moi, elle et ses chats le savent.
Changement de style avec ce concert du trompettiste Erik Truffaz. Après des débuts dans le neo-bop pour ses premiers disques Blue Note, Truffaz a plongé dans le monde du groove, mêlant au fil du temps musiques du monde, rap, hip hop, electro sans jamais sortir totalement du « silo » jazz (pour utiliser un terme dans l’air du temps). A Marciac, en 2018, avec ses partenaires privilégiés Benoit Corboz (keyb) Marcello Giuliani (eb) et Marc Erbetta (dms) et deux invités de marque, le saxophoniste Guillaume Perret, star montante du jazz hexagonal, et le chanteur/rappeur Nya, il joue Trippin’ the Lovelight Fantastic. Un petit air de fête avant de pouvoir la refaire vraiment !
Deux des plus monstrueux musiciens contemporains, Kenny Barron et Dave Holland, qui sont en même temps deux vrais gentlemen du jazz, un standard bop immortel, Billie’s Bounce, un tempo imparable, un swing qui l’est tout autant, pas la moindre dose d’intellect déplacé, le tout au cœur d’un festival éclectique et inventif (Jazz à la Villette). Nous sommes en 2012, il y a huit ans. Et ça déménage, ça bouillonne, ça créativationne à tour de phrases. C’est à ça que sert la technique et pas à s‘échiner à réinventer ce qui l’a déjà été en le rendant juste un rien plus chiant.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Stokely Carmichael explique que les Blancs viennent de perdre le dernier espoir de résoudre pacifiquement le problème racial américain. Le jour de l’assassinat, Nina Simone crée cette chanson, Why dédiée à la mémoire du King Of love. Le 25 mai 2020, Derek Chauvin, une pourriture de flic blanc assassine sauvagement George Floyd à Minneapolis : il faudra plusieurs jours pour qu’il soit simplement arrêté. Lui qui ne mérite même pas la corde pour le pendre, cette corde qui servit au lynchage de tous ces « fruits étranges » évoqués par Billie Holiday. Le jazz, le blues, sont nés de l’esclavage, du racisme, de la violence. La violence appelle la violence et malheureusement, comme le disait fort justement un policier blanc lors d’une manifestation récente, on ne retiendra de ce qui se passe en ce moment que les pillages, les voitures incendiées. Réduisant cette fois encore à néant les possibilités de résoudre pacifiquement la gangrène raciale américaine. Pour le plus grand bonheur de l’homme qui dirige ce pays où on achète des armes aussi facilement que des brioches. Et où la vie d’un Noir ne pèse toujours pas le même poids que celle d’un Blanc. Non, on ne demande pas la mort de Derek Chauvin et de ses sbires, juste qu’ils soient jugés. Comme l’histoire te jugera un jour, Donald.
Notre Toots, version US, star invitée aux plus grands shows tévé, ici avec une Peggy Lee encore en grande forme, dans une série de beaux call and respons sur Making Whoopee. Le morceau est shunté à la fin, mais si vous cherchez trois secondes sur Youtube vous aurez une version complète mais de moins bonne qualité d’image. Au choix.
L’idole de mes 15 ans. Des Animals et d’Otis Redding à Coltrane ou Charlie Parker, ligne droite. Quelques mois après ce concert, Otis allait mourir dans un accident d’avion. I’ve been loving you too long to stop now. Rien à ajouter.
Rarement la section rythmique de Basie aura été aussi bien enregistrée dans une captation video – écoutez la guitare de Freddie Green ! Easin’ it, filmé en Europe en 1962, est aussi le morceau à travers lequel le Count présentait ses sections de trompettes et de trombones. Une séquence quasi didactique : instrument ouvert, sourdine fixe, sourdine wah wah etc. Un festival. Et ces quelques notes de Basie qui font toute la difference.
Coltranien forcené dans les années ’60, explorateur des musiques et des mystiques du monde dans les années ’70, Pharoah Sanders, comme Archie Shepp, allait ensuite réexplorer la tradition, réinventer à sa sauce les standards (sans oublier pour autant son passé libertaire) et redéfinir les limites du lyrisme qui a toujours habité son jeu de saxophone. A Marciac en 2004, il joue le morceau fétiche des ténors, Body and Soul. Le solo de piano est signé Anthony Wonsey. Nat Reeves est à la basse et Joe Farnsworth à la batterie. Corps et âme !
Né à la Nouvelle-Orléans en 1899, le guitariste et chanteur Lonnie Johnson fait ses débuts dans le jazz. En 1917 il part en tournée en Angleterre, échappant ainsi à la grande épidémie de grippe qui vient de décimer sa famille (!!!). Il commence à travailler et à enregistrer comme guitariste de blues puis ayant gagné divers concours, enregistre quelques titres avec Louis Armstrong (Hotter than that en 1927) et Duke Ellington (Hot and Bothered, 1928). Mais c’est essentiellement dans le blues qu’il fera carrière. Guitariste virtuose doté d’un sens mélodique rare, il revient à l’avant-scène au début des sixties en participant aux tournées de l’American Folk Blues Festival. Le voici dans Another night to cry, introduit par son collègue bluesman Sonny Boy Williamson.
En 1958, la chaine américaine NBC diffuse une superbe série d’émissions semi-didactiques sur le jazz : The subject is jazz. Centrée sur un style, une époque, commentée par un spécialiste, l’émission est surtout illustrée par une formation caractéristique du sujet du jour, avec une section rythmique souvent dirigée par le pianiste Billy Taylor. Pour l’émission consacrée au be-bop, les producteurs ont choisi de laisser le champ libre à celui que beaucoup considèrent alors comme le nouveau Parker, l’altiste Cannonball Adderley, en tandem avec son frère Nat Adderley (tp, cn). Le troisième souffleur est cette fois le trombone Jimmy Cleveland et pour compléter la formation le guitariste Mundell Lowe, le bassiste Ed Safranski et le batteur Ed Thigpen. Les thèmes joués seront l’emblématique 52nd street theme, le parkerien Confirmation, le Night in Tunisia de Dizzy, pour ne pas faire de jaloux, le Round Midnight de Thelonious Monk et pour terminer Jeannie (à ne pas confondre avec le Jeannine que joueront souvent Cannonball et Jacques Pelzer.
La parution du disque de Philip Catherine Transparence en 1987 fut un double événement. D’abord parce qu’il s’agissait d’un des premiers disques belges à ne sortir qu’en CD – sur le label Inak – et à susciter un tel émoi chez les amateurs de jazz restés fidèles au vinyl que la firme Timeless céda à la pression et sortit Transparence en 33 tours. Mais si le disque est un tournant, c’est aussi parce que musicalement, il marque le début d’une nouvelle ère dans la carrière du guitariste. Celle de ce qu’on finit par appeler « la ligne claire » en rapport à la terminologie de la BD. Loin des fulgurances jazz-rock, de la virtuosité des guitars all stars, et des disques de sideman, Philip – et cette version récente en garde les traces – privilégiait désormais la mélodie, la pureté du son, la « transparence » de la matière sonore. C’est à Flagey qu’en 2015 le quartet de Philip (avec Nicola Andreoli, Nicolas Fiszman et Hans van Oosterhour) renforcé par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Frank Braley recréait Transparence sur un arrangement de Michel Herr.
L’équation Rollins, ce qui le différencia avant tous les autres des saxophonistes antérieurs fut d’avoir contourné le choix cornélien entre le gros son des maîtres du ténor swing (Hawkins, Webster) et la virtuosité, la fluidité et la rapidité des modernes. Rollins sut jouer très vite et avec le gros son. Cette version de Four a été filmée au Danemark en 1968 avec Kenny Drew, le merveilleux NHOP et Albert Tootie Heath.
Avant de repeindre ses chansons aux couleurs du rock à partir de la deuxième moitié des années ‘70, Jacques Higelin, avec le soutien de Jacques Canetti d’abord puis, surtout de Pierre Barouh (époque Saravah avec Brigitte Fontaine et Areski Belkacem), propose d’abord une musique acoustique proche du jazz ou de la world music. Pianiste lui-même, il fait sa première apparition TV (merci l’INA) le 2 septembre 1966 : en s’accompagnant au piano, puis en imitant avec la voix divers instruments (trombone, contrebasse, batterie) il interprête Quand j’improvise sur mon piano (qui apparait sur l’album Douze chansons d’avant le déluge). Alors, « vous pouvez préférer Minuit Chrétien si ça vous plait », à vous de voir.
Le grand inclassable. L’homme qui incarne, plus que tout autre, le plaisir du jazz. L’autodidacte absolu, incapable de lire une note de musique. Avec Eddie Calhoun et Kelly Martin, à Londres en 1964, il nous offre une intro (courte mais efficace), un exposé particulièrement swinguant, quelques chorus jubilatoires, et une coda au rythme subtil sur la composition de Cole Porter, Just one of those things. Un remède imparable aux coups de blues !
Parmi les grands défenseurs du jazz afro-cubain de ces quarante dernières années, le saxophoniste et clarinettiste Paquito d’Rivera occupe une place à part : avec Diego Urcola (tp) et Milton Cardona (perc, voc) entre autres, il nous offre, en 2000 (et en 6’45) un panorama des différentes facettes de ce cousinage initié, entre autres, par Dizzy et Chano Pozzo dans les années ’40.
Le dernier excès de Charlie Parker (qui en connaissait un brin en matière d’excès) fut un fou-rire face à un show TV de Tommy Dorsey chez la Baronne Nica de Koenigswater. C’était en 1955. Les métros new-yorkais portèrent cette nuit là l’ inscription Bird is alive. Neuf ans plus tard, à Londres, six partenaires réguliers de Parker, six pionniers du be-bop et non des moindres nous rappellent que, de fait, Bird is alive. Howard Mc Ghee (tp) J.J.Johnson (tb) Sonny Stitt (sax) Walter Bishop (pn) Tommy Potter (cb) et Kenny Clarke (dms) jouent Buzzy !
Attention, on sort de notre fameuse zone de confort et on s’accroche pour une petite page freeisante. Représentants majeurs des débuts du jazz mondialiste, le pianiste sud-africain Dollar Brand (Abdullah Ibrahim) et le sax argentin Leandro Gato Barbieri ont fait leurs débuts, ensemble ou séparément dans le free jazz, en Europe. Puis, progressivement, ils ont intégré à cette musique libertaire des accents, des mélodies et des rythmes liés à leurs racines. En 1968, la télévision allemande propose ce qui est sans doute la seule rencontre filmée de ces deux passeurs. En prime, pour cette composition caractéristique de Dollar Brand, l’altiste John Tchicai (un des participants de l’aventure Ascension de Coltrane trois ans plus tôt), le bassiste anglais Barre Phillips et le batteur Makaya Ntshoko. Notez au passage que Gato ne porte pas son légendaire couvre-chef !
Un des themes les plus emblématiques du be-bop historique, Donna Lee, joué à tout berzingue par deux virtuoses absolus de l’alto bop (ou neo-bop, à vous de voir). Le lyrisme échevelé de Stefano di Battista est bien connu des fans de jazz belges depuis l’époque où il avait pour partenaire privilégié notre Eric Legnini. Pour ce concert de 2013 à Jazz sous les Pommiers, Stefano avait invité le musicien français sans doute le mieux à même de se livrer avec lui à une sax battle placé sous le signe de Charlie Parker : Baptiste Herbin. On prend son souffle et on écoute en prime Julian Mazzariello (pn) Daniele Sorrentino (cb) et Roberto Pistolesi (dms). 6’35 de virtuosité, d’énergie et d’imagination surspeedée !
Rhythm is our business ! Eh oui, c’est notre boulot, à nous musiciens, parajazziques, organisateurs, défenseurs de la mémoire bleue. Rhythm is our business ! Pour en témoigner, un Vitaphone de 1936, magnifiquement préservé et restauré et qui est en même temps le seul témoignage filmé de l’orchestre de Jimmie Lunceford, un des deux ou trois meilleurs big bands harlémites de l’avant « swing craze ». Les deux moments forts de ce court métrage sont évidemment les deux chevaux de bataille de l’orchestre, Rhythm is our business et Nagasaki dans lesquels Lunceford présente quelques uns de ses solistes (le batteur James Crawford, le ténor Joe Thomas, le bassiste Moses Allen, le trompette Paul Webster et les chanteurs Willie Smith (également altiste) et Sy Oliver (également trompettiste et arrangeur). Pour le reste, quelques attractions, vocalistes et tap dancers. Un fabuleux condensé d’une époque qui se prépare à sortir de la crise. Comme nous ? Euh…
A partir de son deuxième album, Bobby McFerrin délaisse la fusion high tech pour développer le travail rythmique et vocal de son modèle, Al Jarreau, ouvrant plus larges encore les portes du beatboxing, faisant de la respiration, du corps, du micro autant de nouveaux instruments au service d’une polyrythmie fascinante. Mais au-delà de cette polyrythmie, au-delà de cette polyphonie qui nous donne l’impression d’entendre une formation quasi complète alors qu'il est seul en scène, au-delà de cette capacité à tenir en haleine un public pendant une heure et demie, le plus fascinant est peut-être cette perfection dans le tempo et dans la justesse ! Dès cette époque, tout est déjà dit ou presque.
Ce n’est pas un scoop : l’ancienne maison de Jacques Pelzer, aujourd’hui Jacques Pelzer Jazz Club a longtemps été surnommée L’Hôtel Pelzer, vu le nombre de musiciens américains ou européens qui y déposaient leurs valises pour quelques jours et quelques nuits. C’était un peu l’Hôtel du Grand Balcon à la liégeoise. Le saxophoniste Dave Liebman et le pianiste Richie Beirach faisaient partie des habitués et lorsque Beirach est venu jouer au Jazz à Liège en 2006, il est passé par la Maison du Jazz, a vu la photo de l’homme du Thier et s’est exclamé, presqu’en larmes : « Oh Jack, my man ! ». Le soir, concert superbe au Palais des Congrès avec monsieur Steve Houben (as, fl) Sal LaRocca (cb) et Martijn Vinck (dms) et un très beau Leaving.
C’est à la Nouvelle-Orléans, où était né le jazz, que démarre le neo-bop au début des années ’80. Le mainstream moderne, quelque peu laissé en berne pendant les années free et jazz-rock, reprend vigueur notamment grâce aux frères Marsalis, au sein des Jazz Messengers puis à la tête de leurs propres formations. Tandis que Wynton remonte le temps, réinventant les différentes étapes de l’histoire du jazz, Branford explore de nombreuses facettes de l’univers coltranien. En août 1987, il est à Newport avec à ses côtés le meilleur pianiste de cette relève, Kenny Kirkland, Delbert Felix à la basse et Lewis Nash à la batterie. Et une relecture de plus d’Oleo !
1969. Depuis trois ans, Bill Evans a trouvé, en la personne d’Eddie Gomez, le bassiste-frère qu’il cherchait en vain depuis la mort de Scott LaFaro. Avec Gomez et le batteur Marty Morrell, il enregistre notamment le merveilleux album What’s New avec le flûtiste Jeremy Steig en invité (cfr Blue noon confiné 2 sur le site de la Maison du Jazz). Le trio tourne à travers l’Europe, On retrouve les trois hommes à Helsinki dans une sorte de concert privé où ils jouent notamment cette très belle version d’Emily de Johnny Mandel.
1964, Juan les Pins. Aux côtés de l’organiste Brother Jack McDuff, du sax Red Holloway et du batteur Joe Dukes, les débuts filmés par la RTF d’un formidable guitariste, disciple de Wes Montgomery et qui entame une fulgurante carrière : il s’appelle George Benson !
Aux origines, lorsqu’à la fin du XIXème siècle, il apparut sur les traces des mélopées africaines, des field hollers et des spirituals, le blues du Delta, musique libre et provocante, parlant de sexe, d’alcool, de racisme, de solitude, se contrefichait des trois accords et des douze mesures du blues. Et s’il ressentait l’envie d’ajouter une demi-mesure ici, un accord dissonnant ailleurs, ce balladin qu’était le bluesman ne voyait pas pourquoi il s’en priverait. Privilège de la solibertude, comme disait Jacques-Yvan Duchesne, un bluesman d’un autre genre !
Le saxophoniste qui, après la mort de Coltrane, exerça sans doute la plus grande influence. A Newport, en 1987, aux côtés de Michael Brecker, on pouvait découvrir un véritable all-stars de ce que la fusion a apporté de meilleur au jazz : ça démarre avec la batterie d’Adam Nussbaum, ça se poursuit avec un duo sax/batterie, puis changement de climat avec l’arrivée du piano lumineux de Joey Calderazzo, un intermède d’EWI (Electronic Wind Instrument) puis solo de guitare de monsieur Mike Stern. Pour être complet, le bassiste est Jeff Andrews. Wow ! Si c’est ça la fusion, j’adhère et j’adore !
Un des gros succès de Claude Nougaro à l’époque où, malgré son orientation et son instrumentation jazz, on continuait à le cataloguer « yé-yé ». A la fin de cette version télévisée de Je suis sous, qui date de 1964, il est rejoint par deux joyeux compagnons de guindaille que vous reconnaîtrez sans peine. Pas sûr que Marie-Christine a apprécié !
Un. Tony Bennett, né en 1926, crooner vétéran. Deux. Amy Winehouse, née en 1983, morte en 2011 (les fameux 27 ans), chanteuse rock, soul mais qui avait tout en elle pour faire aussi une grande chanteuse de jazz. Trois. Une chanson, Body and soul, de Heyman et Green, créée en 1930 et appelée à devenir le standard le plus enregistré. Vous mixez ces trois éléments dans les studios Abbey Road un jour de mars 2011. Et vous versez une ou deux grosses larmes en pensant qu’Amy Winehouse ne sera plus là en juillet pour la sortie de ce Body and soul sur le disque Duets II de Tony Bennett.
Avant de devenir la star grand public que l’on sait, Al Jarreau a littéralement chamboulé l’univers du jazz vocal, en travaillant la voix, la respiration, le corps, comme personne ne l’avait fait jusqu’alors (sinon dans des domaines expérimentaux). Maître à chanter de Bobby McFerrin, précurseur du beatboxing, il a réinventé de manière radicale des classiques comme ce Take Five chanté en 1976.
Une mélodie hyper connue, extraite de l’album culte We get request. Une formule instrumentale parmi les plus courantes. Et pourtant, de la première à la dernière note, de l’intro minimaliste et sensible entre Bach et Michel Legrand au torrent de notes du four beat en passant par l’installation de « la chose » par le two beats, il y a ce quelque chose qui nous aide à vivre : le swing ! Oscar Peterson, Ray Brown, Ed Thigpen made in Holland.
On surnommait Frank Sinatra The Voice. Mais nous aussi, on avait notre Voix. Elle vient de s’éteindre et le monde de la radio francophone en Belgique a perdu du même coup un de ses derniers géants. Il nous faudra vivre en trois dimensions désormais, amputés que nous sommes de la quatrième, incarnée par Stéphane Dupont. Qui fut aussi notre partenaire dans les Inspecteurs des Riffs sur 48FM. Nous lui rendrons hommage ultérieurement. Salut, Stéphane et en attendant, on écoute ce mercredi l’autre Voix, avec en bonus madame Ella Fitzgerald. Humour, swing, complicité.
Il y a quelques années, les Three Cohens donnaient un superbe concert au Mithra jazz à Liège ; il y a deux ans, rebelotte avec le quartet d’Avishai Cohen (le trompettiste) feat Yonathan Avishai (pn) - et cet after mémorable au Reflektor ! La famille Cohen est au cœur de la scène contemporaine. Après les frères Jones, les frères Heath, les frères Adderley ou la famille Marsalis, cette nouvelle fratrie bleue navigue entre l’histoire et l’actualité du jazz. On retrouve Avishai (tp) Anat (cl) et Yuval (ss) en compagnie de Yonathan Avishai, Barak Mori et Jeff Ballard à la Villette en 2018. Ils jouent The mooche de Duke Ellington.
Le Duke, dans une de ses premières captations en couleur, en 1962. VIP's Boogie, c'est le morceau de présentation des solistes, ce qui nous permet de voir et d’entendre successivement (et sauf erreur de ma part) Harry Carney (bs) Jimmy Hamilton (cl) Harold Shorty Baker (tp) Paul Gonsalves (ts) Lawrence Brown (tb) Russell Procope (as) Bill Berry (tp) Ray Nance (tp) Ed Mullens (tp) et Cat Anderson (tp) ! Johnny Hodges est mis en valeur dans d’autres morceaux du show. Une autre fois peut-être. Bon début de semaine à vous !
La plus musicienne des grandes dames du jazz, Sarah Vaughan, surnommée Le Marin par ses musiciens pour son langage fleuri ! Une tessiture qui s’étend avec les années. Une profondeur de voix qui, sans rien perdre du swing et la musicalité qui avaient fait son succès, Sassy rejoint à certains égards les grandes chanteuses de gospel et les grandes cantatrices. L’aisance avec laquelle, sur ce My funny Valentine filmé au Northsea en 1980, elle passe du grave à l’aigu laisse pantois. Un jour, avec Milou Struvay, nous avons arrêté la voiture en pleine circulation pour pouvoir écouter la chanson jusqu’au bout !
Sans doute le trio qui connut la plus grande longévité : lorsque Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack de Johnette enregistrent leur premier album consacré aux standards, en 1983, personne ne peut imaginer que l’aventure va durer plus de trente ans ! Cette version d’Oleo a été filmée à Tokyo en 1993. On peut aimer ou ne pas aimer le personnage. Il faut être de bien mauvaise fois pour ne pas aimer la musique de Jarrett.
1972. Mingus sort d’une période creuse. Il va bientôt se trouver de nouveaux partenaires (George Adams, Don Pullen) qui lui permettront de monter son dernier grand quintet. En attendant, il essaye différentes formules, mêlant les générations et les univers musicaux. Pour ce Perdido, on aura ainsi côte à côte l’Ellingtonien Cat Anderson, en belle forme et le baryton post-free Hamiett Bluiett, ainsi que le trompettiste Joe Gardner et le pianiste John Foster (polyvalent comme l’était son prédécesseur Jaki Byard). Exceptionnellement, Dannie Richmond est remplacé par le batteur Roy Brooks.
Ce document miraculeusement retrouvé par la Sonuma (dont il faut encore et encore soutenir le travail) a circulé il y a quelques mois, mais en cette journée internationale du jazz, en ces temps où les musiciens galèrent plus encore que d’habitude, il n’est pas inutile de reparler de ces temps que les moins de 20 ans etc. Au temps où Steve Houben et Henri Pousseur avaient réussi l’exploit improbable de faire entrer la « musique de nègres » au conservatoire royal de Liège. Vous reconnaitrez (peut-être) au passage Garrett List, Richard Rousselet, Charles Loos, Michel Debrulle, Antoine Cirri, Denis Pousseur, Jean-Pol Danhier, Pierre Bernard, Pirly Zurstrassen, Pierre Vaiana, Jean-Pierre Urbano et bien d’autres.
https://www.sonuma.be/archive/le-jazz-s_invite-au-conservatoire-de-liege
Paris, 15 janvier 1970. Le merveilleux trio que forment depuis l’année précédente René Thomas, Eddy Louiss et Kenny Clarke sont filmés par la télévision française. Trois titres sont mis en boite : Don’t want nothing, un sublime You’ve changed et la composition la plus connue de René, Meeting. Au menu également, des interviews des trois musiciens par Jean-Louis Ginibre. Je pense que l’ensemble est encore accessible sur le site de l’INA. En attendant, on patiente (on a l’habitude ces derniers temps) avec ce Meeting au titre lui aussi bien d’actualité !
Dans l’excellente série « Legends of Jazz » orchestrée par le pianiste Ramsey Lewis, un des deux épisodes consacrés à la voix met en présence la chanteuse Jane Monheit et le chanteur et guitariste John Pizzarelli (dont le swinguant paternel, guitariste lui aussi, Bucky Pizzarelli, vient de nous quitter). Pizzarelli Jr démarre en solitaire avec le verse. Et pour le reste, ça swingue du début à la fin sur le thème des frères Gershwin « They can’t take that away from me ».
Après Art Blakey et les jazz Messengers il y a quelques jours, l’autre grande phalange hard-bop des années ’50, le quintet du pianiste Horace Silver. Avec Blue Mitchell (tp) Junior Cook (ts) Gene Taylor (cb) et Louis Hayes, Horace Silver nous offre un Cool eyes filmé lors d’une tournée européenne de la fin des années ’50. Emblématique !
Une version d’Ain’t misbehaven de Fats Waller pour les fans de guitare : monsieur Joe Pass, spécialiste de l’exercice sans filet est ici présenté par son ami Oscar Peterson. Bon dimanche (de guitare - oui bon ok).
Parmi les représentants les plus pugnaces du « grand jazz » contemporain, celui qui a sans doute joué le plus souvent à Liège ces dernières années (Jazz à Liège, Reflektor, Ardentes…) est le trompettiste Christian Scott. En 2013, trompette pointée vers le ciel comme Dizzy, il reprend avec fougue la composition d’Herbie Hancock, Eye of the Hurricane. Avec Braxton Cook (sax) Matthew Stevens (gt) Lawrence Fields (pn) Kris Funn (cb) et Corey Fonville (dms)
Vendredi, les grands classiques du film musical avec cette fois la rencontre sur grand écran de Louis Armstrong et de Billie Holiday. New-Orleans est un film d’Arthur Lubin (1946) qui retrace (avec quelques anachronismes à la clé) les derniers jours de Storyville, le quartier réservé de la ville où naquit le jazz. Dans ce Do you know what it means to miss New Orleans, vous reconnaîtrez aussi Kid Ory, Barney Bigard, Red Callender etc.
Un grand, grand classique du hard-bop ce jeudi, jours des cours. On connait ça par coeur mais on ne s'en lasse pas. 1958, les Jazz Messengers grande cuvée (Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons, Jimmie Merritt, Art Blakey) débarquent en Belgique. Le concert de Bruxelles, filmé, restera longtemps dans les tiroirs de la RTBF pour cause de mauvais étiquetage. Il en est sorti depuis, nous offrant au passage un concert de rêve, dans lequel on peut notamment entendre l’emblématique Moanin’ de Bobby Timmons. Le thème en call and respons vous restera dans l’oreille pour le reste du confinement. Au moins.
Une page rétro. Quelques jours déjà qu’on n’a plus remonté le temps ensemble. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas les big bands (et spécialement les big bands blancs) on ne peut pas nier le charme de cet énorme succès de l’orchestre du clarinettiste Artie Shaw (1938). Begin the beguine aurait été écrit par Cole Porter, le plus politiquement incorrect des auteurs de standards de Tin Pan Alley, au bar du Ritz, à Paris, en 1935. Cette chanson ne respecte pas les 32 mesures des songs usuels : pour ceux que ça intéresse, elle compte 108 mesures de forme AABACC’ ! Je dis ça, je dis rien.
Mon petit-fils réclame du jazz dansant. Faisons d’une pierre deux coups, en retrouvant Troy Andrews, tromboniste et chanteur orléanais, mieux connu sous le nom de Trombone Shorty (parce qu’il a démarré très tôt, à un âge où il était encore haut comme trois pommes). Cette version de St James Infirmary a pour cadre un lieu assez particulier : la Maison Blanche, mais la Maison Blanche à l’époque où son locataire n’était pas le sinistre guignol que l’on sait, mais un certain Barak Obama. Ok, Obama n’était sans doute pas irréprochable mais qu’est-ce qu’on aimerait pourtant le retrouver en ce moment à la tête du pays en perdition qui a donné naissance au jazz. Et puis, sérieusement, vous imaginez le Trump reprendre Hi de Hi de Hi de Ho ?
Ca ne vous aura pas échappé, les temps sont à la mélancolie. Alors autant s‘offrir le meilleur de la mélancolie avec cette langue portugaise, inséparable de la bossa et des musiques apparentées. Sur scène, Maria Bethania et Chico Buarque, deux icones dont les retrouvailles en 1982 sont particulièrement émouvantes. Sem Fantasia (Ao Vivo).
Après l’intimisme de Shirley Horn, le muscle et la bonne humeur des jams. Une des spécialités du Northsea Jazz Festival de la grande époque, c’était ces fameuses “tenor sax jazz battles” qui concluaient les agapes et où une selection des grands tenors presents se retrouvaient pour une jam. Ca pouvait donner le pire (succession de soli sans imagination, musiciens fatigues ou défoncés) mais aussi le meilleur : c’est le cas dans ce Flying home de 1979 (et pourtant les participants sont de sacrés phénomènes!). Accompagnés par Hank Jones, Gene Ramey et Gus Johnson, vous entendrez dans l’ordre Budd Johnson, Dexter Gordon et Illinois Jacquet (Buddy Tate joue le bridge pendant l'exposé) Arnett Cobb ne participant qu'aux collectives. One, two, on